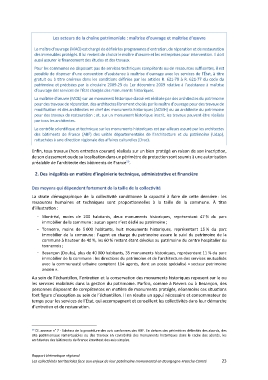Page 25 - ROD2 - RTR - Observations + réponses
P. 25
Les acteurs de la chaîne patrimoniale : maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le maître d’ouvrage (MAO) est chargé de définir les programmes d’entretien, de réparation et de restauration
des immeubles protégés. Il lui revient de choisir le maître d’œuvre et les entreprises pour intervention. Il doit
aussi assurer le financement des études et des travaux.
Pour les communes ne disposant pas de services techniques compétents ou de ressources suffisantes, il est
possible de disposer d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec les services de l’État, à titre
gratuit ou à titre onéreux dans les conditions définies par les articles R. 621-70 à R. 621-77 du code du
patrimoine et précisées par la circulaire 2009-23 du 1er décembre 2009 relative à l’assistance à maîtrise
d’ouvrage des services de l’État chargés des monuments historiques.
La maîtrise d’œuvre (MOE) sur un monument historique classé est réalisée par des architectes du patrimoine
pour des travaux de réparation, des architectes librement choisis par le maître d’ouvrage pour des travaux de
modification et des architectes en chef des monuments historiques (ACMH) ou un architecte du patrimoine
pour des travaux de restauration ; et, sur un monument historique inscrit, les travaux peuvent être réalisés
par tous les architectes.
Le contrôle scientifique et technique sur les monuments historiques est par ailleurs assuré par les architectes
des bâtiments de France (ABF) des unités départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap),
rattachées à une direction régionale des affaires culturelles (Drac).
Enfin, tous travaux (hors entre#en courant) réalisés sur un bien protégé en raison de son inscrip#on,
de son classement ou de sa localisa#on dans un périmètre de protec#on sont soumis à une autorisa#on
préalable de l’architecte des bâ#ments de France39.
2. Des inégalités en ma/ère d’ingénierie technique, administra/ve et financière
Des moyens qui dépendent fortement de la taille de la collec/vité
La strate démographique de la collec#vité condi#onne la capacité à faire de ce<e dernière : les
ressources humaines et techniques sont propor#onnelles à la taille de la commune. À #tre
d’illustra#on :
- Montréal, moins de 200 habitants, deux monuments historiques, représentant 47 % du parc
immobilier de la commune : aucun agent n’est dédié au patrimoine ;
- Tonnerre, moins de 5 000 habitants, huit monuments historiques, représentant 15 % du parc
immobilier de la commune : l’agent en charge du patrimoine assure le suivi du patrimoine de la
commune à hauteur de 40 %, les 60 % restant étant dévolus au patrimoine du centre hospitalier du
tonnerrois ;
- Besançon (Doubs), plus de 40 000 habitants, 35 monuments historiques, représentant 11 % du parc
immobilier de la commune : les directions du patrimoine et de l’architecture des services mutualisés
avec la communauté urbaine comptent 114 agents, dont un poste spécialisé « secteur patrimoine
ancien ».
Au sein de l’échan#llon, l’entre#en et la conserva#on des monuments historiques reposent sur le ou
les services mobilisés dans la ges#on du patrimoine. Parfois, comme à Nevers ou à Besançon, des
personnes disposent de compétences en ma#ère de monuments protégés, néanmoins ces situa#ons
font figure d’excep#on au sein de l’échan#llon. Il en résulte un appui nécessaire et consommateur de
temps pour les services de l’État, qui accompagnent et conseillent les collec#vités dans leur démarche
d’entre#en et de restaura#on.
39 Cf. annexe n° 7 - Schéma de la procédure des avis conformes des ABF. En dehors des périmètres délimités des abords, des
site patrimoniaux remarquables ou des travaux en covisibilité des monuments historiques dans le cadre des abords, les
architectes des bâtiments de France émettent des avis simples.
Rapport théma que régional 23
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté