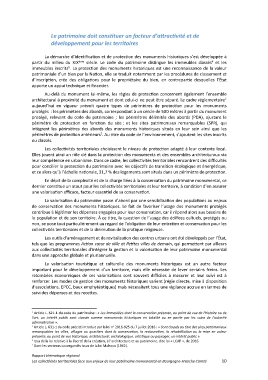Page 12 - ROD2 - RTR - Observations + réponses
P. 12
Le patrimoine doit cons tuer un facteur d’a rac vité et de
développement pour les territoires
La démarche d’iden#fica#on et de protec#on des monuments historiques s’est développée à
par#r du milieu du XIXème siècle. Le code du patrimoine dis#ngue les immeubles classés4 et les
immeubles inscrits5. La protec#on des monuments historiques est une reconnaissance de la valeur
patrimoniale d’un bien par la Na#on, elle se traduit notamment par les procédures de classement et
d’inscrip#on, crée des obliga#ons pour le propriétaire du bien, en contrepar#e desquelles l’État
apporte un appui technique et financier.
Au-delà du monument lui-même, les règles de protec#on concernent également l’ensemble
architectural à proximité du monument et dont celui-ci ne peut être séparé. Le cadre réglementaire6
aujourd’hui en vigueur prévoit quatre types de périmètres de protec#on pour les monuments
protégés : les périmètres des abords, correspondant à un cercle de 500 mètres à par#r du monument
protégé, relevant du code du patrimoine ; les périmètres délimités des abords (PDA), ajustant le
périmètre de protec#on en fonc#on du site ; et les sites patrimoniaux remarquables (SPR), qui
intègrent les périmètres des abords des monuments historiques situés en leur sein ainsi que les
périmètres de protec#on antérieurs7. Au #tre du code de l’environnement, s’ajoutent les sites inscrits
ou classés.
Les collec#vités territoriales choisissent le niveau de protec#on adapté à leur contexte local.
Elles jouent ainsi un rôle clé dans la protec#on des monuments et des ensembles architecturaux via
leur compétence en urbanisme. Dans ce cadre, les collec#vités territoriales rencontrent des difficultés
pour concilier la protec#on du patrimoine avec les objec#fs de transi#on écologique et énergé#que,
et ce alors qu’à l’échelle na#onale, 31,7 % des logements sont situés dans un périmètre de protec#on.
En dépit de la complexité et de la charge liées à la conserva#on du patrimoine monumental, ce
dernier cons#tue un atout pour les collec#vités territoriales et leur territoire, à condi#on d’en assurer
une valorisa#on efficace, facteur essen#el de sa conserva#on.
La valorisa#on du patrimoine passe d’abord par une sensibilisa#on des popula#ons au enjeux
de conserva#on des monuments historiques. Le fait de favoriser l’usage des monuments protégés
contribue à légi#mer les dépenses engagées pour leur conserva#on, car il répond alors aux besoins de
la popula#on et de son territoire. À ce #tre, la ques#on de l’usage des édifices cultuels, protégés ou
non, se pose tout par#culièrement au regard de l’obliga#on de leur entre#en et conserva#on pour les
collec#vités territoriales et de la diminu#on de la pra#que religieuse.
Les ou#ls d’aménagement et de revitalisa#on des centres urbains ont été développés par l’État,
tels que les programmes Ac on cœur de ville et Pe tes villes de demain, qui perme<ent par ailleurs
aux collec#vités territoriales d’intégrer la ges#on et la valorisa#on de leur patrimoine monumental
dans une approche globale et pluriannuelle.
La valorisa#on touris#que et culturelle des monuments historiques est un autre facteur
important pour le développement d’un territoire, mais elle nécessite de lever certains freins. Les
retombées économiques de ces valorisa#ons sont souvent difficiles à mesurer et leur suivi est à
renforcer. Les modes de ges#on des monuments historiques varient (régie directe, mise à disposi#on
d'associa#ons, EPCC, baux emphytéo#ques) mais nécessitent tous une vigilance accrue en termes de
suivi des dépenses et des rece<es.
4 Article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité
administrative ».
5 Article L. 631-1 du code précité introduit par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux
remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur
présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».
6 Issu de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi « LCAP », de 2016.
7 Dont les secteurs sauvegardés issus de la loi Malraux (1962).
Rapport théma que régional 10
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté