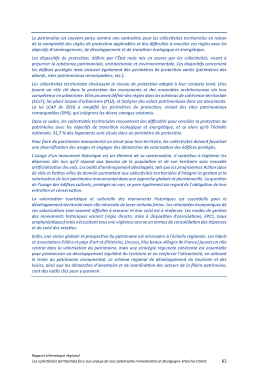Page 65 - ROD2 - RTR - Observations + réponses
P. 65
Le patrimoine est souvent perçu comme une contrainte pour les collec vités territoriales en raison
de la complexité des règles de protec on applicables et des difficultés à concilier ces règles avec les
objec fs d’aménagement, de développement et de transi on écologique et énergé que.
Les disposi fs de protec on, définis par l'État mais mis en œuvre par les collec vités, visent à
préserver la cohérence patrimoniale, architecturale et environnementale. Ces disposi fs concernent
les édifices protégés mais incluent également des périmètres de protec on variés (périmètres des
abords, sites patrimoniaux remarquables, etc.).
Les collec vités territoriales choisissent le niveau de protec on adapté à leur contexte local. Elles
jouent un rôle clé dans la protec on des monuments et des ensembles architecturaux via leur
compétence en urbanisme. Elles peuvent définir des règles dans les schémas de cohérence territoriale
(SCoT), les plans locaux d'urbanisme (PLU), et intégrer des volets patrimoniaux dans ces documents.
La loi LCAP de 2016 a simplifié les périmètres de protec on, créant des sites patrimoniaux
remarquables (SPR), qui intègrent les divers zonages existants.
Dans ce cadre, les collec vités territoriales rencontrent des difficultés pour concilier la protec on du
patrimoine avec les objec fs de transi on écologique et énergé que, et ce alors qu’à l’échelle
na onale, 31,7 % des logements sont situés dans un périmètre de protec on.
Pour faire du patrimoine monumental un atout pour leur territoire, les collec vités doivent favoriser
une diversifica on des usages et engager des démarches de valorisa on des édifices protégés.
L’usage d’un monument historique est un élément de sa conserva on. Il contribue à légi mer les
dépenses dès lors qu’il répond aux besoins de la popula on et de son territoire sans nouvelle
ar ficialisa on des sols. Les ou ls d’aménagement développés, tels que les programmes Ac on cœur
de ville et Pe tes villes de demain perme ent aux collec vités territoriales d’intégrer la ges on et la
valorisa on de leur patrimoine monumental dans une approche globale et pluriannuelle. La ques on
de l’usage des édifices cultuels, protégés ou non, se pose également au regard de l’obliga on de leur
entre en et conserva on.
La valorisa on touris que et culturelle des monuments historiques est essen elle pour le
développement territorial mais elle nécessite de lever certains freins. Les retombées économiques de
ces valorisa ons sont souvent difficiles à mesurer et leur suivi est à renforcer. Les modes de ges on
des monuments historiques varient (régie directe, mise à disposi on d'associa ons, EPCC, baux
emphytéo ques) mais nécessitent tous une vigilance accrue en termes de consolida on des dépenses
et de suivi des rece es.
Enfin, une vision globale et prospec ve du patrimoine est nécessaire à l'échelle régionale. Les labels
et associa ons (Villes et pays d'art et d'histoire, Unesco, Plus beaux villages de France) jouent un rôle
central dans la valorisa on du patrimoine, mais une stratégie régionale cohérente est essen elle
pour promouvoir un développement équilibré du territoire et en renforcer l’a rac vité, en u lisant
le levier du patrimoine monumental. Le schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs, ainsi que les démarches d'inventaire et de coordina on des acteurs de la filière patrimoine,
sont des ou ls clés pour y parvenir.
Rapport théma que régional 63
Les collec vités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental en Bourgogne-Franche-Comté